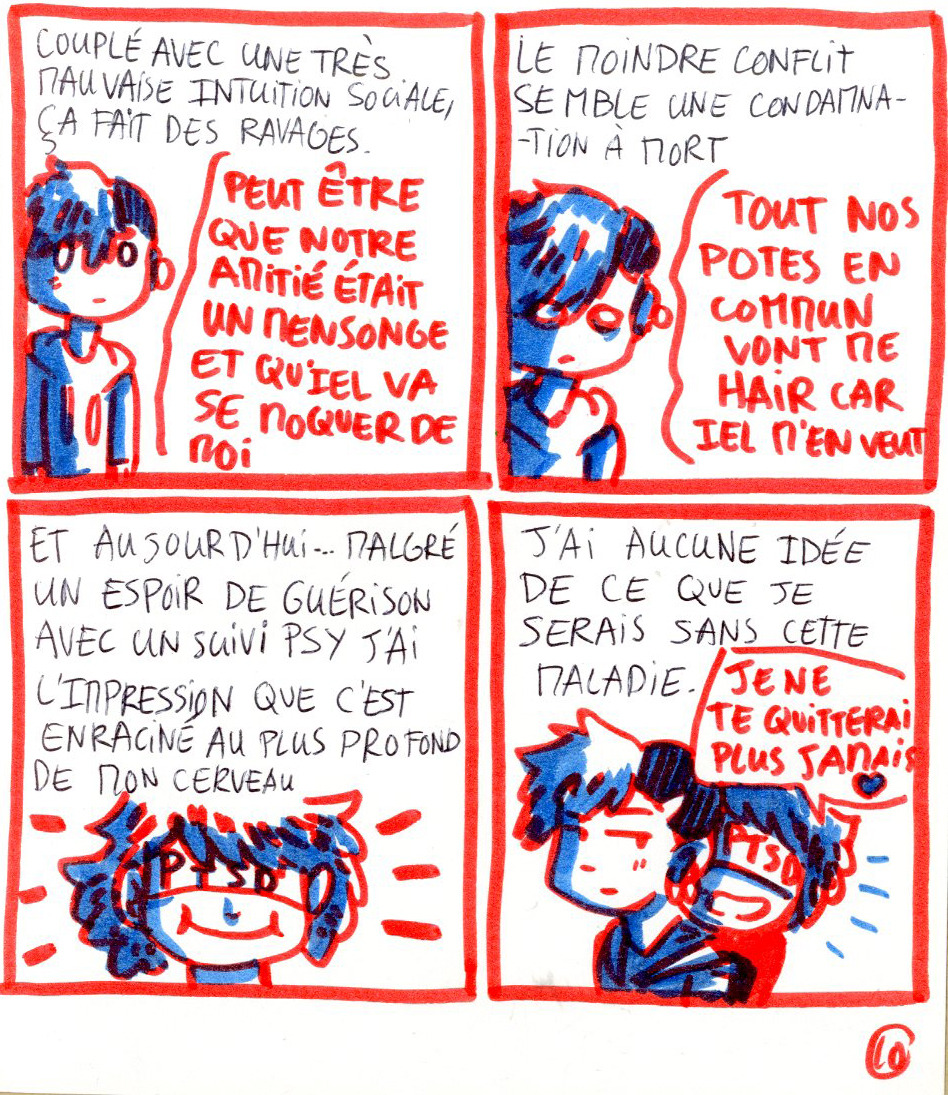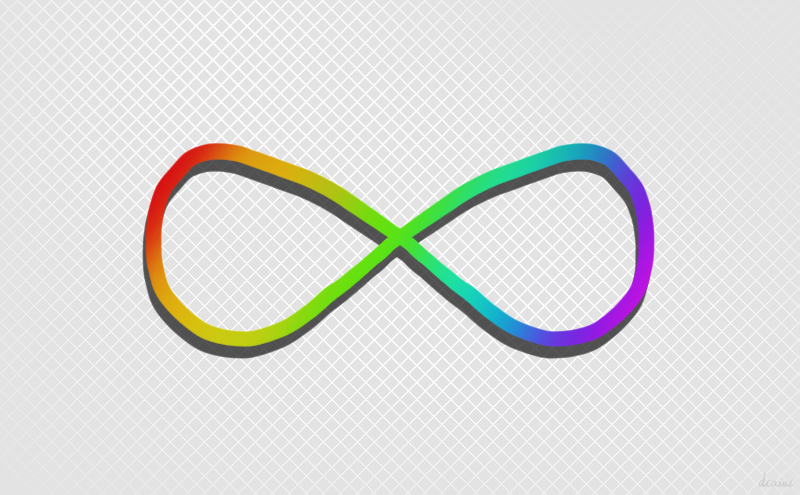Comme nous sommes beaucoup à critiquer Les Petites Victoires en ce moment, quelqu’un m’a demandé quels livres il fallait lire sur l’autisme.
Voici donc une compilation de livres sur l’autisme écrits par des personnes autistes, en français :
– Dans ta bulle ! de Julie Dachez

– La Fille Pas Sympa de Julia March
– La Différence Invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline (BD)
– Va, chasse la grisaille d’Éliane Lanovaz
– Nos Intelligences Multiples de Josef Schovanec
– Dans le cerveau des autistes de Temple Grandin
– Aspergirls de Rudy Simone
– Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet

– L’empereur, c’est moi de Hugo Horiot
Nota bene : je ne suis pas forcément en accord avec tout le contenu des ouvrages cités, mais ces livres ont au moins le mérite de donner la parole aux personnes concernées. Je n’ai pas encore lu ou pas encore fini la totalité des livres de cette liste. J’ai tout particulièrement apprécié les deux livres de Julie Dachez, et j’ai trouvé la diversité de témoignages dans Aspergirls vraiment précieuse. L’excellent roman d’Éliane Lanovaz présente différents personnages neurodivergents, dont une femme autiste. J’aime beaucoup l’écriture et le fond des propos de Schovanec, mais je le trouve moins accessible ; son style est parfois ampoulé — ce qui ne me déplaît pas mais je le recommanderais moins largement car je sais que ça en découragerait certain-e-s.
En anglais, voici d’autres recommandations :
– The ABC of Autism Acceptance de Sparrow Rose Jones

– Loud Hands, autistic people speaking (anthologie)
– All the weight of our dreams: on living racialised autism (anthologie)
Un livre que je recommanderais vivement bien qu’il ne soit pas écrit pas une personne autiste mais un allié, et dont j’ai déjà parlé ici : NeuroTribes de Steve Silberman.
Si vous avez une recommandation à ajouter, n’hésitez pas à m’envoyer un email ou un tweet (si vous laissez un commentaire, il y a de fortes chances qu’il se perde au milieu des spams).
Edit : Quelques ajouts qu’on m’a recommandés via Twitter (merci beaucoup !)
[En français]

– La vie à mille décibels de Rachael Lucas (The State of Grace en VO)
– Une personne à part entière de Gunilla Gerland
– Si on me touche je n’existe plus de Donna Williams
– Les autres livres de Josef Schovanec sur l’autisme, notamment Je suis à l’Est !
[En anglais]
– The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism et Fall Down 7 Times Get Up 8: A Young Man’s Voice from the Silence of Autism de Naoki Higashida
– Uniquely Human de Dr Barry M. Prizant

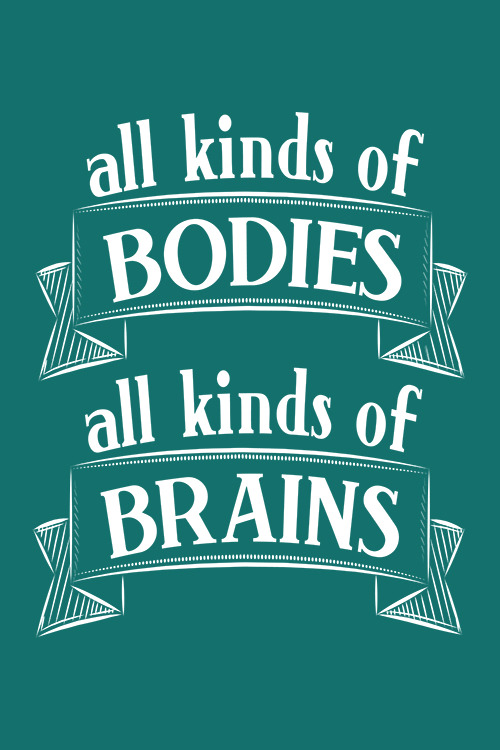

 Il y a beaucoup de ressources anglophones à disposition sur le sujet, notamment le site
Il y a beaucoup de ressources anglophones à disposition sur le sujet, notamment le site